La direction de l’attractivité territoriale de Courbevoie prolonge le focus sur l’IA amorcé dans son magazine Courbevoie.eco de juin.
Retrouvez ici ce numéro de Courbevoie.eco : “L'avenir orienté IA”.
L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) a permis à de nombreux domaines (robotique, ingénierie, santé, transports ou encore télécommunications) de faire des bonds de géants en matière d’innovation. Les IA autonomes ne se contentent plus simplement d’exécuter des tâches mais désormais, elles optimisent, résolvent et vont parfois… jusqu’à inventer. Et c’est là que cette nouvelle réalité se heurte à une problématique : peut-on breveter une invention générée par une IA ? Qui en est l’inventeur, au regard du droit ? Et surtout, comment le droit des brevets s’adapte-t-il ?
IA et brevet : le défi juridique au cœur de l’innovation
Selon une étude menée par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en juillet 2024, durant la dernière décennie le nombre de familles de brevets en IA générative est passé de 733 en 2014 à plus de 14 000 en 2023. Par ailleurs, plus de 25% des brevets et plus de 45% des publications scientifiques en IA générative ont été émises durant la seule année 2023, suite au boom du lancement de ChatGPT dans sa version gratuite. À l’Office européen des brevets (OEB), le nombre de dépôts liés à l’IA augmente de plus de 20% par an depuis 2016.

« L’IA irrigue absolument tous les domaines de notre société, de l’IA embarquée au sein d’un véhicule autonome, à la maintenance prédictive d’un aéronef, en passant par le service de radiologie d’un hôpital ou encore les trajets des chariots-élévateurs qui récupèrent des colis dans un entrepôt logistique », énumère Lauriane Delaye, responsable du pôle électrotechnique-commande à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), l’office français en charge de la délivrance des brevets. L’ingénieure précise que si un programme d’IA ne peut être reconnu comme inventeur, une invention ayant recours à l’IA comme outil peut néanmoins être brevetable.
Nouveauté, inventivité et industrialisation

Comme toute invention, elle doit satisfaire aux critères de l’article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle : être nouvelle, impliquer une activité inventive, tout en permettant une application industrielle. « À cet égard, elle doit contribuer au caractère technique de l’invention, en fournissant une solution technique à un problème technique par des moyens techniques ou par le traitement de données techniques mesurées », indique Hanane El Harrak, ingénieure responsable du pôle réseaux et traitement de données à l’INPI.
Autrement dit, l’IA en tant que telle n’est pas brevetable, elle est considérée comme une simple méthode mathématique basée sur des modèles de calcul mis en œuvre par ordinateur. « En revanche, un brevet peut être envisagé lorsqu’elle est utilisée pour des applications techniques, comme lorsqu’elle aide à la reconnaissance d’une tumeur sur une série d’image médicales ou bien à la commande en temps réel d’un outil sur un chantier, par exemple », ajoute H. El Harrak.
Les choses se compliquent lorsqu’une IA joue un rôle déterminant dans la conception même de l’invention. Se pose alors la question de l’origine réelle de l’invention : qui en est l’auteur, lorsque le résultat inédit produit par l’IA est simplement supervisé et validé par un être humain ?
Clarifier le rôle entre individus et systèmes d’IA
Face à des enjeux de plus en plus complexes, le droit des brevets semble parfois dépassé et challengé par les initiatives de certains pays dont les régulateurs envisagent des évolutions législatives. À l’INPI, selon L. Delaye, « des référents ont été formés et nous participons régulièrement à des groupes de travail avec l’OEB et l’OMPI pour harmoniser le traitement des demandes de brevets, échanger sur nos pratiques et surtout anticiper les défis juridiques et leurs conséquences sur la gestion des droits de propriété intellectuelle ».
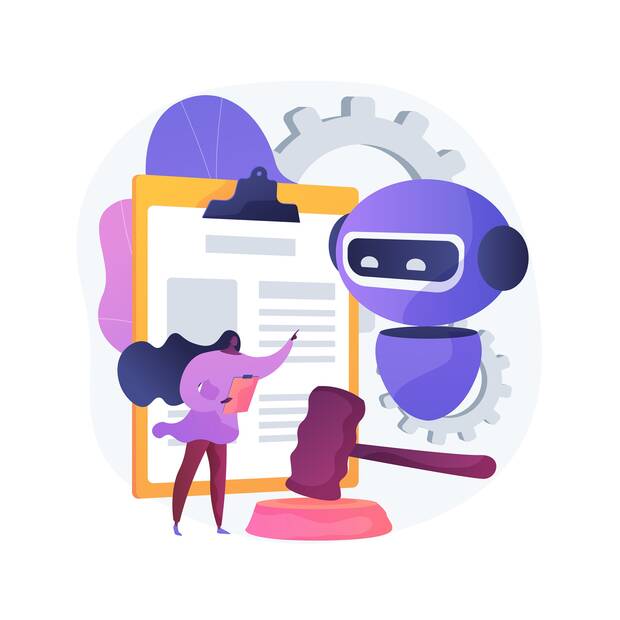
Pour l’heure, à défaut de brevet, d’autres mécanismes peuvent être mobilisés : secret des affaires, contrats, clauses de confidentialité qui protègent le savoir-faire d’une entreprise mais ne garantissent pas le même niveau de protection. Du côté de l’Europe, l’IA Act qui entrera progressivement en vigueur à partir de 2026, impose plus de transparence sur les modèles d’entraînement des algorithmes, sans pour autant modifier le droit des brevets. Or, si la loi n’est plus totalement adaptée à ces nouvelles formes d’innovation, elle pourrait être amenée à évoluer pour répondre à des intérêts non seulement techniques et économiques mais aussi éthiques et sécuritaires.

